Une publication très attendue
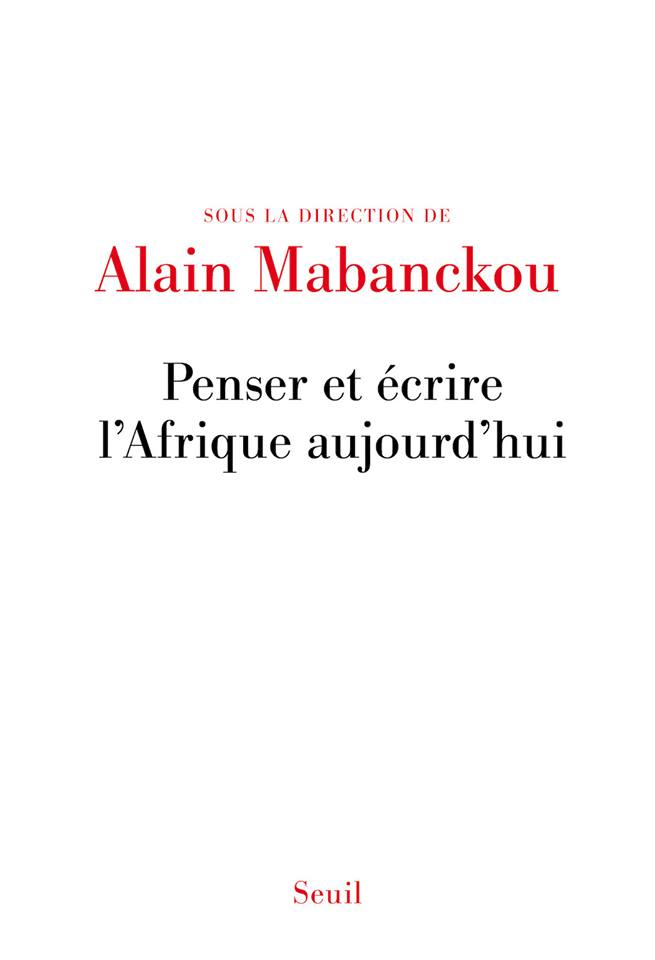 Les compagnons des Vagabonds sans trêves ne peuvent ignorer qu’Alain Mabanckou a organisé, le 2 mai 2016, au Collège de France, le colloque Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui.
Les compagnons des Vagabonds sans trêves ne peuvent ignorer qu’Alain Mabanckou a organisé, le 2 mai 2016, au Collège de France, le colloque Penser et écrire l’Afrique aujourd’hui.

Alain Mabanckou, Collège de France, Colloque Penser et écrire l’Afrique, 2 mai 2016
Alain Mabanckou a annoncé la parution aux éditions du Seuil, le 2 février 2017, du colloque, déjà qualifié d’historique ! L’ouvrage reprendra les textes de Dany Laferrière, Achille Mbembe, Pascal Blanchard, Célestin Monga, François Durpaire, Rokhaya Diallo, Dominic Thomas, Françoise Vergès, Lydie Moudileno, Severine Kodjo-Grandvaux, Lucy Mushita, Souleymane Diagne, Maboula Soumahoro, Tchak, Marc Alexandre Oho Bambe, Niangouna, Gauz, Abdourahman Waberi et, bien entendu, Alain Mabanckou.
Les nomades impatients peuvent toujours vagabonder sur le blog avec le compte-rendu des interventions de : Alain Mabanckou, Marc Alexandre Oho Bambe, Séverine Kodjo-Grandvaux, Lydie Moudileno, Souleymane Bachir Diagne. Parmi les intervenants, une écrivaine a touché l’assemblée : Lucy Mushita qui est née dans l’actuelle Zimbabwe et a écrit Chinongwa, un roman dont Les vagabonds sans trêves vous parleront bientôt. Je vous encourage à regarder la vidéo de son intervention : Africaines d’aujourd’hui, Africaines d’hier, et entendre la voix émue et consternée de cette personnalité sensible raconter comment, en arrivant en France, elle est devenue une « femme africaine ». J’ai admiré son courage de décrire le quotidien en paroles et en actes de l’érotisation du corps africain. Dans son témoignage, je me suis vue et j’ai vu d’autres femmes de tous âges à la peau diversement foncées. Que Lucy Mushita ait été applaudie comme aucun autre orateur m’a fait un bien fou ! J’ai repensé à la première fois où j’avais assisté aux comportements pénibles qu’elle dépeignait : c’était avec ma mère bio. J’avais six ans et demi et je venais d’arriver en Belgique. Trois semaines après le colloque, j’ai commencé à écrire la fiction La fée fêlée et la petite chose noire. En voici un extrait :
« Tous s’en tiennent à l’évidence d’elle très belle. Il est vrai qu’autant de beauté dans un corps si frêle parfaitement est égarant. Devant cette apothéose du menu, les gens, bouche bée, tombent en arrêt. Captivés, dans la rue, cloués et recloués par la surprise, les passants envoûtés ne passent plus… Au garde-à-vous de la grâce, hommes, femmes, enfants, tous ont des yeux nus d’anges déchus qui découvrent l’inespéré, croisent, par hasard, au milieu de l’automne, un bris de paradis dégringolé sur terre.
Dans la famille du père pâle, rebelote ! Les mots émus disent toujours le plaisir de revoir la charmante qui offre une combinaison unique de légèreté et de lenteur. N’est-ce pas qu’elle évoque le pas chinois d’un petit pied bandé ? Cependant, dans la famille, elle est à l’aise. On a appris à la connaître, à apprécier ses qualités sensibles, sa modestie, son respect du prochain avec lequel elle rit et fait preuve de bonté. Son âme souffre quand l’autre souffre. À sa façon vivante d’écouter, de répondre, je le sens. Dans la famille, elle a la paix. Elle n’est plus, comme au-dehors, la perpétuelle dévisagée que la curiosité indiscrète questionne. L’insistance épie. Parce que les gens ne savent rien d’elle et qu’ils ne savent pas grand-chose d’eux-mêmes aussi. Ils ne savent pas faire de l’heureux avec ce qui commence en soi dans la rencontre de l’autre. Ils ne savent pas l’accueil du désir soudain. Ils ont appris la crainte du débordement des sentiments. Ils ont appris la contrainte du mépris des sens, le puritanisme dont la voix interdit l’exubérance d’être un corps et les largesses de l’amour libre. Ils ont appris, à la radio, au cinéma, à la télévision, dans les journaux, les revues, les livres que les images, prises dans les pays lointains, des êtres dévêtus, dansants, exultants, possédés, souriants, mystérieux, naïfs, musclés, érotiques racontent une histoire de sauvagerie, de certitude de chaos, de bord de civilisation qu’il faut domestiquer…
Alors, les gens fixent la belle inconnue. Dans les lieux publics, leurs yeux lui demandent d’où elle tire sa préciosité de porcelaine miel doré ? Sa délicatesse de statuette d’ambre ? Son pouvoir altier de léviter, tranquille, au-dessus de l’ensemble monochrome gris charbonnier ? Cette séduction unique ? Dans la petite ville de province où nous habitons, elle est la nonpareille : la féerie importée d’un ailleurs de forêts vierges et de savanes dangereuses où le règne des bêtes féroces embrasse celui d’êtres humains pas toujours pacifiques.
Lorsqu’ils lui demandent d’où elle vient, le malentendu demeure. Le nom entendu n’est pas une réalité géographique : ce sont les coordonnés d’un imaginaire de félicité alizé ; c’est la latitude d’une invitation au rêve voyageur dans l’exotisme indolent bordé de palmiers ; c’est le moyen d’évasion vers l’oisiveté îlienne et les amours océanes promesses exquises de nuit dorée sur tranche de plage de cocotiers et fond de rires sonores dont la sincérité ensoleillée caillasse le nihilisme souterrain. Oui voilà, l’image de la nonpareille correspond aux repères de l’archipel du bonheur, reproduit sur les cartes postales, et qui rappelle que l’humain n’a pas toujours été exploité dans les ténèbres ouvrières d’en bas, pas toujours été enterré par l’enfer de pyrotechnie sans merci des coups de grisou : personne n’a oublié la catastrophe de la mine du bois du Cazier !
L’ordinaire de l’exploitation du charbon, c’est le mal qui grignote, en douce, les poumons. Partout dans le pays noir, ça crache et ça tousse, mais quand la nonpareille passe, ça jure, bon sang de bonsoir et s’étrangle de joie et, dès qu’elle a le dos tourné, me glisse à l’oreille : dis, comment s’appelle ta grande sœur ? De la belle inconnue, d’aucuns aimeraient davantage que la rêverie de l’échantillon des délices à ciel ouvert. Plus que la vision fugace de sa longue chevelure d’un marron luxueux sur un port de tête solaire, preuve en est, s’il fallait la faire, que Gauguin n’a pas exagéré et le douanier Rousseau rien imaginé. »



0 commentaires